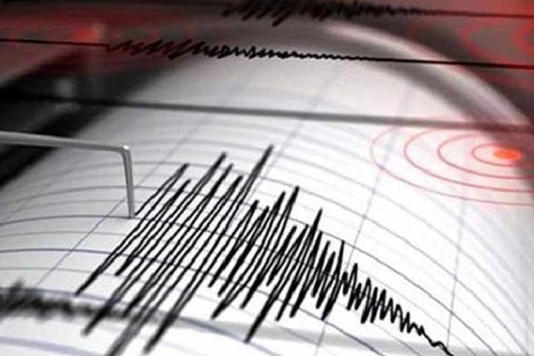- Chapelle Sixtine , Cité du Vatican et de Rome
Connue dans le monde entier, la chapelle Sixtine est l'une des attractions phares de la Cité du Vatican, et de Rome. Elle attire chaque année des millions de visiteurs de tous horizons. Construite au XVè, elle doit notamment sa célébrité à sa décoration signée des plus grands artistes de la Renaissance, notamment Michel-Ange, Botticelli et Ghirlandaio. La voûte, magnifiquement peinte par Michel-Ange, en est le chef d'oeuvre. Elle représente la création d'Adam et d'autres scènes bibliques. C'est également ici que les les cardinaux se réunissent quand ils doivent élire un nouveau pape.
- Colisée de Rome
- Alhambra Grenade (Espagne)
- Taj Mahal, Agra (Inde)
- Machu Picchu, Aguas Calientes (Pérou)
- Sagrada Família, Barcelone (Espagne)
- Cathédrale Notre-Dame de Paris
- Tour Eiffel, Paris (France)
- Ruines de Petra, Wadi Musa (Jordanie)
- Temples d'Angkor, Siem Reap (Cambodge)
- Château de Versailles
- LE CHÂTEAU DE NEUSCHWANSTEIN – Allemagne
Pour la construction de ce château romantique, l’architecte Eduard Riebel allia les styles roman et gothique aux techniques modernes du XIXe siècle. Pourtant l’ambition démesurée de ce projet engloutit la fortune du roi En 1884, Louis II s’installa dans le château mais, accusé de folie par les ministres bavarois, il fut retrouvé noyé deux ans plus tard… Aujourd’hui, le Château de Neuschwanstein accueille plus d’un million de visiteurs par an.
- LA STATUE DE LA LIBERTÉ – Etats-Unis
L’idée a germé dans la tête d’Edouard de Laboulaye, professeur au Collège de France, en 1865. Le projet est tout de suite confié au sculpteur français Frédéric Bartholdi avec la collaboration de Gustave Eiffel pour la charpente métallique. En 1876, la statue est offerte par la France pour le centenaire de l’Indépendance des Etats-Unis.
En 1903, un poème d’Emma Lazarus, intitulé The New Colossus, a été accroché à la base du monument : «Donnez-moi vos pauvres, vos exténués qui en rangs serrés aspirent à vivre libres, le rebut de tes rivages surpeuplés, envoie-les moi, les déshérités, que la tempête m’apporte, de ma lumière, j’éclaire la porte d’or ! »
Aujourd’hui encore, la Statue de la Liberté est un symbole d’idéaux tels que les droits de l’Homme, la paix, la démocratie et la chance. Depuis 1984, ce monument est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
- LA BASILIQUE SAINT-MARC – Italie
Mais en 976, l’église est détruite par un incendie. C’est le Doge Domenico Contarini qui ordonne en 1063 une reconstruction plus vaste de l’édifice.
A l’époque, Constantinople donne le ton. Ses architectes sont sollicités dans le monde entier. C’est d’ailleurs pour cette raison que la Basilique Saint-Marc est imprégnée des techniques de l’Orient.
A l’intérieur de cette église à coupoles, on découvre les mosaïques d’or qui recouvrent les parois de la basilique, les centaines de colonnes polychromes, les marqueteries de marbre sur le sol… et le trésor de l’édifice : la Pala d’Oro, un chef-d’oeuvre d’orfèvrerie datant du XIVe siècle. Ce tableau d’autel en or est composé de 3 000 pierres précieuses et de 80 émaux.
- Les monuments de STONEHENGE – Angleterre
Pour certains experts il s’agit d’une sépulture. En effet, de nombreux ossements humains ont été trouvés sur le site. En revanche pour les astronomes, il s’agit plutôt d’un observatoire astronomique : les mégalithes s’ordonnent en des lignes de visées mettant en valeur des phénomènes astronomiques. Ces pierres matérialiseraient les solstices, les équinoxes, les éclipses, les levers et les couchers de soleil et de lune.
Le site attire chaque année près d’un million de visiteurs. La beauté des lieux prête à la méditation, on comprend son classement parmi les 25 plus beaux monuments du Monde.
- LES MOAÏS DE L’ÎLE DE PÂQUES – Chili
On en dénombre environ 900 sur l’île. Certaines d’entre elles sont achevées, d’autres sont à l’état d’ébauche. Taillées entre le IXe et le XVIIe siècle, ces statues sont sculptées dans du tuf issu principalement de la carrière de Rano Raraku. Leurs yeux sont faits d’os de requins et leurs pupilles sont incrustées de corail. Leur taille varie de 3 à 20 mètres pour un poids moyen de 14 tonnes.
Les Moaïs ont été dressés dos à l’océan. Ils protégeaient ainsi le peuple contre le monde extérieur. Il existe cependant une exception : le « Ahu Akivi », un alignement de 7 Moaïs qui regardent en direction de l’océan.
Près de 300 ans après la découverte de l’île de Pâques par le néerlandais Jakob Roggeven, les raisons qui ont poussé les Rapa Nui, peuple de l’île, à ériger ces statues restent inconnues. Symbole de protection ? L’Histoire ne le dit pas. En tout cas certainement dans la liste des 25 plus beaux monuments du Monde.
- L’OPERA DE SYDNEY – Australie
Le succès de l’Opéra de Sydney est, sans nul doute, dû à son architecture si originale : il est composé de 3 groupes de coquilles voutées et entrelacées. Il est aussi supporté par 580 piliers de béton qui s’enfoncent jusqu’il 25 mètres au-dessous de la mer et sa toiture est dotée de plus d’un million de tuiles en céramique blanche.
Aujourd’hui, l’Opéra de Sydney est constitué de 5 théâtres, 5 studios de répétition, 4 restaurants et 6 bars. Ses besoins électriques équivalent ceux d’une ville de 25 000 habitants !
Le 28 juin 2007, cet édifice a été consacré Patrimoine mondial de l’UNESCO. Nul doute qu’il soit un des plus beaux monuments du Monde.
- L’ACROPOLE D’ATHÈNES – Grèce
Au Ve siècle avant J.-C., un groupe d’artistes met en œuvre les plans d’aménagement de l’Acropole réalisés par Périclès et transforme, sous la direction du sculpteur Phéidias, la colline rocheuse en un ensemble architectural extraordinaire. Ils sont certainement parmi les plus beaux monuments du Monde.
Les principaux monuments érigés à cette époque sont le Temple Erechthéion ; le Parthénon, sanctuaire consacré à Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse ; le Temple d’Athéna Nikê, déesse de la victoire ; et les Propylées, vestibules conduisant aux sanctuaires.
Pendant l’Antiquité, l’Acropole servait de refuge pour le culte des dieux de la mythologie grecque.
L’Acropole a été déclarée Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1987.
- LA CATHÉDRALE BASILE-LE-BIENHEUREUX – Russie
En 1554, le tsar Ivan IV, le fameux Ivan le Terrible, ordonna la construction de ce monument pour commémorer sa victoire sur les Tatars. L’architecte de cet édifice est inconnu mais selon la légende, le Tsar ordonna qu’on lui crève les yeux pour qu’il ne puisse plus reproduire une œuvre aussi belle.
Lors de la grande période communiste, l’église fut fermée et aucun office n’eut lieu pendant près de 70 ans. Staline, le Secrétaire Général du parti communiste de Russie, avait même demandé que le monument soit rasé, parce qu’il gênait le passage des troupes pour les défilés militaires. Heureusement pour ce monument parmi les plus beaux monuments du Monde, il n’en fut rien !
La Cathédrale fut nominée Saint-Basile car elle abrite dans l’une de ses chapelles, le tombeau de Basile-le-Bienheureux, un simple d’esprit qui avait prédit la victoire d’Ivan le Terrible.
- LA BASILIQUE SAINTE SOPHIE – Turquie
C’est en 537 que l’empereur Justinien décida de la rebâtir. Sa construction nécessita pas moins de 10 000 ouvriers et seulement 5 ans de travaux.
Elle fut la plus grande église du monde chrétien jusqu’à sa transformation en mosquée par les Ottomans en 1453. Les minarets et les mausolées datent de cette époque.
Sa coupole de 31 mètres de diamètre, sa porte impériale surmontée d’une magnifique mosaïque d’un Christ en majesté, ses lettres d’or, sa nef, ses colonnes de porphyre, ses vitraux… cette basilique est incontestablement le premier chef-d’œuvre de l’ère byzantine.
En 1934, la Basilique Sainte Sophie est devenue un musée.
- LE CHRIST RÉDEMPTEUR – Brésil
Dans les années 1920, l’église catholique perd bon nombre de fidèles au profit de la franc-maçonnerie et du positivisme. Ériger une statue du Christ devient alors pour l’église le moyen de réaffirmer son influence.
En 1931, le monument, dessiné par le sculpteur français Paul Landowski, est inauguré. La cérémonie est grandiose. Le soir, des dizaines de milliers d’habitants participent à une retraite aux flambeaux.
L’objectif est atteint. 80 ans plus tard, la magie opère toujours. Chaque année, pas moins de 600 000 visiteurs se pressent pour monter dans le train électrique qui traverse le parc national de Tijuca, pour atteindre le légendaire sommet.
- EL CASTILLO DE CHICHEN ITZA – Mexique
Il ne s’agit pas de la plus haute pyramide de la région (elle mesure quand même 24 mètres) mais elle est celle qui se trouve dans le meilleur état de conservation. Depuis 2007, il est d’ailleurs interdit de monter sur la pyramide pour éviter les détériorations.
El Castillo a une vocation calendaire. En effet, la civilisation maya développait l’astro-architecture consistant à allier les connaissances astronomiques au savoir-faire architectural.
- LE TEMPLE DE BOROBUDUR – Indonésie
Construit par des rois hindouistes pour célébrer la gloire du Bouddha, Borobudur est occupé jusqu’au XIIe siècle. Il est ensuite abandonné lorsque le bouddhisme connaît une décadence. En 1948, l’UNESCO entreprend de restaurer le temple qui redevient ainsi un lieu de culte et de pèlerinage.
Sur une surface de 2 500m², les murs du Borobudur sont ornés de bas-reliefs dont la longueur totale est de 6 km ! Taillés dans la pierre volcanique, ces bas-reliefs relatent la vie du chef spirituel Sakyamuni (« l’Eveillé »), fondateur du bouddhisme. Un des plus beaux monuments du Monde.
- L’ABBAYE DU MONT SAINT-MICHEL – France
Tout commence en l’an 709. L’évêque Saint Aubert, affirme avoir été enjoint par l’Archange Michel, de construire une chapelle sur un rocher désert, le futur Mont Saint-Michel. Près de 300 ans plus tard, en 966, des moines bénédictins s’y installent.
Très vite, la chapelle devient trop petite et la communauté chrétienne décide de construire une immense abbaye qui devint un lieu de pèlerinage majeur de l’Occident chrétien. Au XIIIe siècle, de nouvelles constructions s’édifient au Nord, six salles magnifiques qui seront immédiatement dénommées : la Merveille. En 1793, les moines sont chassés par la Révolution et l’Abbaye est transformée en prison. Elle le restera jusqu’en 1864.
Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979, le Mont Saint-Michel reçoit plus de 3 millions de visiteurs par an. La louange quotidienne est désormais assurée par les Fraternités monastiques de Jérusalem.
- BIG BEN – Angleterre
C’est en 1856 qu’une première cloche fut suspendue mais en quelques mois, elle se fendit. En 1858, on décida alors de concevoir une nouvelle cloche qui elle aussi, se fendit ! Abîmée mais toujours opérationnelle, c’est elle qui depuis 154 ans donne l’heure aux Londoniens.
Tous les 31 décembre, c’est également Big Ben qui annonce dans tous les foyers anglais le début de la nouvelle année. Le son est retransmis sur toutes les radios et les chaînes de télévision du pays.
- LE MONT RUSHMORE – Etats-Unis
De gauche à droite : George Washington (1789-1799), défenseur de l’indépendance ; Thomas Jefferson (1801-1809), rédacteur de la Déclaration de l’Indépendance ; Théodore Roosevelt (1901-1909), Prix Nobel de la Paix et Abraham Lincoln (1861-1865), qui abolit l’esclavage.
Ainsi, le Mont Rushmore est parfois appelé le sanctuaire de la démocratie. Parmi les plus beaux monuments du Monde à découvrir.
Cette sculpture est une idée de l’historien Doane Robinson. Son but : développer l’activité touristique dans région pour relancer l’économie. La sculpture de 18 mètres de haut a été réalisée par le sculpteur Gutzon Borglum entre 1927 et 1941.
Le mémorial du Mont Rushmore attire chaque année 2 millions de visiteurs.
- LE TEMPLE KIYOMIZU-DERA – Japon
En contrebas des terrasses du temple, se trouve la chute d’eau Otowa-no-taki. Selon la légende, cette eau promet santé, longévité et succès dans les études à quiconque la boira.
Par ailleurs, le temple est à l’origine de l’expression japonaise se jeter du Kiyomizu-dera », l’équivalent de « se jeter à l’eau ». En effet, durant la période Edo (1600-1868), il était coutume de croire que si une personne survivait à un saut depuis la plateforme du temple, son voeu s’exaucerait. Au total, 234 sauts de 13 mètres ont été comptabilisés avec un taux de survie de 85,4%… Bien sûr, cette pratique est désormais interdite !
- LA GRANDE MURAILLE – Chine
C’est vers 220 avant J.-C., pour défendre la frontière nord de la Chine des invasions, que l’empereur Qin Shi Huang entreprit de réunir les tronçons de fortifications existants. Construite en pierre, en terre ou en brique, suivant les ressources des régions traversées, elle est ponctuée de bastions et de tours de guets sur toute sa longueur.
On prête à la Grande Muraille, la réputation d’être le plus grand cimetière du monde.
En effet, près de 10 millions d’ouvriers auraient été enterrés dans ses environs.
La Grande Muraille de Chine est un chef-d’oeuvre inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1987.